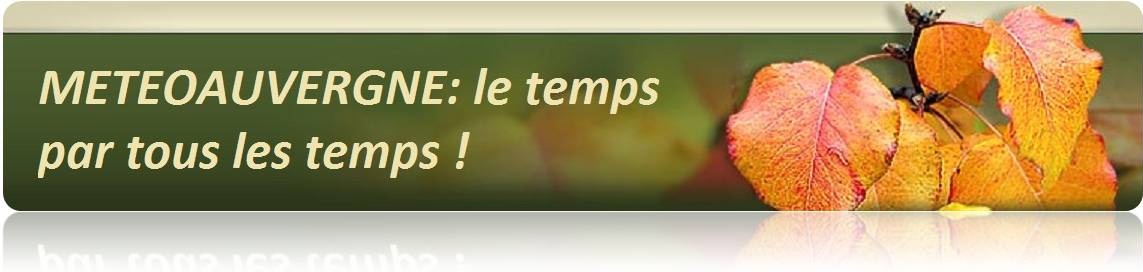

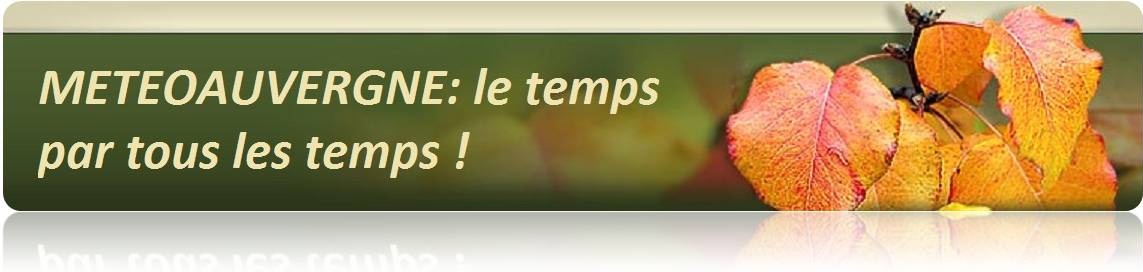

II-Les Ultraviolets
Le soleil nous apporte bien-être et vitalité ; sait-on qu'il permet, par exemple, la synthèse de la vitamine D, essentielle pour notre organisme ? Pourtant, il arrive aussi qu'il agresse notre corps ; et face à ce redoutable adversaire, nous ne sommes pas tous égaux : car chacun de nous possède un « capital soleil » prédéterminé, qui diffère d'une personne à l'autre en fonction de caractéristiques génétiques et culturelles. Dès lors, il faut savoir nous protéger de certains effets pernicieux du rayonnement solaire sans être privés pour autant de ses actions bénéfiques ; pour cela, des habitudes sont à prendre, adaptables elles aussi à chacun : ces habitudes sont résumées plus loin dans les Conseils santé. Ainsi pourrons-nous nous prévenir contre certains risques sanitaires aujourd'hui bien connus des spécialistes médicaux, et qui se matérialisent tantôt à court terme, comme les coups de soleil, tantôt à moyen ou long terme, comme certains cancers de la peau (dont les mélanomes), la cataracte, les déficiences immunitaires.
D'où proviennent ces risques ? Essentiellement, de l'action des rayons ultraviolets , les « UV » , émis par le soleil. Tous ne parviennent pas jusqu'à nous : le taux d'ultraviolets arrivant à la surface de la Terre (mesurable en termes d'énergie) dépend notamment de paramètres météorologiques tels que la couverture nuageuse (encore appelée nébulosité) ou la concentration en ozone dans la stratosphère. C'est pourquoi l'OMM , l'Organisation météorologique mondiale , s'est associée à l'OMS , l'Organisation mondiale de la santé , pour aider à la prévention des dangers suscités par le rayonnement solaire : ces deux organisations de l'ONU ont mis en place une échelle du risque solaire, permettant de quantifier ce risque et nommée l'index UV. Sur le territoire de la France métropolitaine, les valeurs de l'index UV sont publiées par l'association Sécurité Solaire, qui collabore avec Météo-France pour en déterminer les estimations du jour et prévoir celles des deux jours suivants.
 Sans l’énergie en provenance du soleil, la Terre serait un gigantesque désert de roches. C’est lui, en effet, qui nous procure lumière et chaleur et qui maintient l’économie de l’ensemble de la biosphère, constituant ainsi notre unique source de vie. Mais les rayonnements électromagnétiques que nous envoie le soleil sont très divers dans leurs capacités d’interaction avec notre planète, et leurs caractéristiques se répartissent suivant un spectre dont les UV n’occupent qu’une partie réduite.
Sans l’énergie en provenance du soleil, la Terre serait un gigantesque désert de roches. C’est lui, en effet, qui nous procure lumière et chaleur et qui maintient l’économie de l’ensemble de la biosphère, constituant ainsi notre unique source de vie. Mais les rayonnements électromagnétiques que nous envoie le soleil sont très divers dans leurs capacités d’interaction avec notre planète, et leurs caractéristiques se répartissent suivant un spectre dont les UV n’occupent qu’une partie réduite.
Le spectre solaire  Le rayonnement solaire global propage une énergie qui peut être considérée comme transmise aussi bien sous forme de particules immatérielles que sous forme d'ondes. Ces ondes se distinguent par leur fréquence (leur nombre d'oscillations par seconde, mesuré en hertz) : la longueur d'onde d'un rayonnement de ce genre est égale à la vitesse de la lumière dans le vide (300 000 kilomètres par seconde), divisée par la fréquence. Les particules, en nombre immense, sont appelées des photons : chaque photon véhicule une énergie proportionnelle à la fréquence du rayonnement, et donc d'autant plus grande que sa longueur d'onde est plus petite. Pour étudier le spectre solaire, on classe les différents rayonnements qui le composent en fonction de l'ordre de grandeur de leurs longueurs d'onde :
Le rayonnement solaire global propage une énergie qui peut être considérée comme transmise aussi bien sous forme de particules immatérielles que sous forme d'ondes. Ces ondes se distinguent par leur fréquence (leur nombre d'oscillations par seconde, mesuré en hertz) : la longueur d'onde d'un rayonnement de ce genre est égale à la vitesse de la lumière dans le vide (300 000 kilomètres par seconde), divisée par la fréquence. Les particules, en nombre immense, sont appelées des photons : chaque photon véhicule une énergie proportionnelle à la fréquence du rayonnement, et donc d'autant plus grande que sa longueur d'onde est plus petite. Pour étudier le spectre solaire, on classe les différents rayonnements qui le composent en fonction de l'ordre de grandeur de leurs longueurs d'onde :
• Les rayons très énergétiques, comme les rayons X et les rayons gamma, ont de très courtes longueurs d'onde, inférieures à 100 nanomètres (le nanomètre, écrit en abrégé nm, est le milliardième de mètre). Ces rayons ne parviennent pas à terre, car ils sont absorbés par les couches supérieures de l'atmosphère , la thermosphère et la mésosphère , au-dessus de 50 km d'altitude.
• Les rayons peu énergétiques, comme les ondes radio, ont des longueurs d'onde supérieures à 1 400 nm. Ces ondes restent très faibles à la surface de la Terre, car elles sont elles aussi partiellement absorbées par les couches supérieures de l'atmosphère.
Ainsi, les principaux rayonnements arrivant sur la surface terrestre composent la lumière, entre 100 et 1 400 nm. Ce sont les rayons auxquels l'organisme humain doit faire face ; ils se répartissent en rayons infrarouges, visibles et ultraviolets :
• Le rayonnement infrarouge (noté IR) va de 800 à 1 400 nm de longueur d'onde. Ces rayons sont invisibles, mais une partie d'entre eux sont perçus sous forme de chaleur par l'organisme. La surface terrestre perd beaucoup d'énergie thermique par émission de rayonnement infrarouge (également par convection et conduction), mais la majeure partie de cette énergie est absorbée par certains composants de l'atmosphère , notamment l'eau , qui réémettent le rayonnement infrarouge vers le bas : c'est grâce à cet « effet de serre » atmosphérique que la température moyenne de la surface de la Terre et des basses couches de l'atmosphère peut être maintenue à une valeur suffisamment élevée.
• Le rayonnement visible va de 400 à 800 nm. C'est le rayonnement perçu par la rétine humaine, et qui nous permet donc de distinguer les formes avec leurs reliefs ainsi que les couleurs, réparties sur l'arc-en-ciel (ou sur le spectre du prisme) depuis la fréquence la moins énergétique , celle du rouge , jusqu'à la plus énergétique , celle du violet. En outre, c'est le rayonnement visible qui fournit l'énergie nécessaire à la photosynthèse des matières organiques par les plantes.
• Le rayonnement ultraviolet (les UV) va de 100 à 400 nm. Invisibles comme les infrarouges, ces rayons n'en sont pas moins dangereux lorsque l'organisme se trouve en surexposition par rapport à eux, car ils entrent alors en interaction avec la matière vivante et créent dans son fonctionnement différents troubles.
Les trois types d'ultraviolets
Des différences entre les actions physiques, chimiques et biologiques des rayons ultraviolets conduisent à diviser la gamme de leurs longueurs d'onde en trois créneaux, définissant chacun un type d'ultraviolets. Les frontières entre ces créneaux, bien sûr, ont une certaine continuité et ne se limitent pas à des chiffres uniques ; on peut cependant en proposer des limites conventionnelles, telles que celles auxquelles se réfère l'OMM. Ainsi :
• Les UV-A correspondent aux longueurs d'onde allant de 315 à 400 nm. Ils représentent 95 % des ultraviolets solaires parvenant à la surface de la Terre. Le danger que représente ce type d'UV n'apparaît pas forcément d'emblée, car leur action, lente et cumulative, n'est perceptible qu'à long terme.
• Les UV-B correspondent aux longueurs d'onde allant de 280 à 315 nm. Ils représentent 5 % des UV solaires parvenant à la surface de la Terre. Contrairement aux UV-A, leurs effets s'observent déjà à court terme, puisque ce sont eux qui provoquent l'apparition des coups de soleil (en association, peut-être, avec les infrarouges). Mais il existe aussi pour ce type d'ultraviolets, comme pour les UV-A, une action cumulative, qui présente des risques à long terme. D'autre part, les UV-B sont partiellement absorbés par l'ozone.
• Les UV-C correspondent aux longueurs d'onde allant de 100 à 280 nm. Ce sont les ultraviolets les plus agressifs ; mais ils sont en principe absorbés totalement à haute altitude, dès qu'ils traversent les régions les plus élevées de la couche d'ozone, et cela même si la concentration en ozone dans ces régions est faible.
 La quantité d’énergie véhiculée pendant une seconde par les ultraviolets solaires et parvenant sur une étendue de un mètre carré de la surface terrestre définit sur cette étendue un « taux d’ultraviolets au sol » ou, pour mieux dire, un éclairement énergétique qui, dans un créneau de longueurs d’onde fixé, varie en fonction de nombreux paramètres météorologiques (et astronomiques). Tout d’abord, pour arriver jusqu’au sol, les ultraviolets doivent traverser l’atmosphère, et durant ce voyage, les rayons subissent de nombreuses modifications ; plus précisément, le rayonnement solaire y est modifié par trois phénomènes :
La quantité d’énergie véhiculée pendant une seconde par les ultraviolets solaires et parvenant sur une étendue de un mètre carré de la surface terrestre définit sur cette étendue un « taux d’ultraviolets au sol » ou, pour mieux dire, un éclairement énergétique qui, dans un créneau de longueurs d’onde fixé, varie en fonction de nombreux paramètres météorologiques (et astronomiques). Tout d’abord, pour arriver jusqu’au sol, les ultraviolets doivent traverser l’atmosphère, et durant ce voyage, les rayons subissent de nombreuses modifications ; plus précisément, le rayonnement solaire y est modifié par trois phénomènes :
• l’absorption (par les molécules de certains gaz, dont l’ozone),
• la diffusion (à travers les nuages, l’ atmosphère et les aérosols),
• la réflexion (par les nuages, l’atmosphère et les aérosols), qu’il s’agisse d’une réflexion directe (comme pour les miroirs) ou d’une réflexion diffuse (par diffusion en retour).
Notons que la surface terrestre peut aussi réfléchir les rayons solaires, qui sont alors replongés dans l’atmosphère où ils subissent un nouveau parcours.
L’absorption par les molécules de gaz
Lorsqu’un photon, au cours de son trajet, rencontre une molécule d’un gaz donné, il peut être absorbé par celle-ci sous certaines conditions, qui dépendent à la fois de la nature du gaz et de la fréquence du rayonnement électromagnétique représenté par le photon : ce dernier apporte alors l’énergie nécessaire pour provoquer, par exemple, une dissociation de la molécule de gaz en deux autres molécules. Ce mécanisme, dans les longueurs d’onde de l’ultraviolet, a en particulier pour conséquence la formation d’ozone à partir de l’oxygène stratosphérique : ainsi, la concentration en ozone, faible dans la troposphère (c’est-à-dire la basse atmosphère, depuis la surface terrestre jusqu’à environ 8 km d’altitude dans les régions polaires, 12 dans les régions tempérées, 18 dans les régions tropicales) et dans la mésosphère (au-delà d’une cinquantaine de km d’altitude), s’accroît fortement dans la stratosphère, entre la troposphère et la mésosphère, où la « couche d’ozone » stratosphérique atteint un maximum de concentration vers 25 ou 30 km d’altitude. Au sein de cette couche se produisent des réactions chimiques nombreuses et opposées d’où finit par émerger un équilibre complexe et fragile, dans lequel certains composés gazeux, parfois en très faible proportion, jouent un rôle essentiel de catalyse.
Tous ces catalyseurs ne proviennent pas de produits naturels. À cet égard, on a mis en lumière, ces dernières décennies, le rôle joué par l’insertion progressive dans la stratosphère des chlorofluorocarbures ou CFC. En effet, ces produits industriels sont dissociés dans certaines conditions par les photons UV en libérant des catalyseurs qui initient des réactions de destruction de l’ozone. Ce processus polluant de réduction de l’ozone stratosphérique, très complexe en fait, est à l’origine du phénomène du « trou d’ozone », autrement dit, de la diminution considérable de la concentration en ozone affectant la stratosphère (principalement aux hautes latitudes de l’hémisphère Sud) depuis un quart de siècle environ. Or, la couche d’ozone exerce un rôle de filtre pour les UV-B et C, de sorte que son affaiblissement a pour conséquence une augmentation du taux des UV qui pénètrent jusqu’au sol : par exemple, une diminution de 1 % de l’ozone atmosphérique entraîne une augmentation de 2 % du rayonnement UV-B. Ainsi, les risques que représentent les UV pour la santé ne peuvent qu’être accentués par le phénomène du « trou d’ozone » qui, bien que les CFC ne soient plus émis désormais, devrait persister de manière assez durable en raison de la grande stabilité chimique de ces gaz.
Il est vrai que l’on doit considérer non seulement l’ozone stratosphérique, mais l’ensemble de l’ozone de l’atmosphère, c’est-à-dire, pratiquement, le contenu de celle-ci en ozone troposphérique et stratosphérique, intégré verticalement à partir du sol et ramené aux conditions normales de température (0 degré Celsius) et de pression (1 013,25 hectopascals) : ainsi définit-on une grandeur météorologique, la colonne d’ozone totale. Cependant, l’ozone contenu dans les basses couches de l’atmosphère reste avant tout un polluant atmosphérique dont le rôle de filtre pour les UV demeure faible, contrairement à l’ozone stratosphérique ; en particulier, la présence de cet ozone troposphérique ne compense aucunement le déficit engendré par le « trou d’ozone ».
La diffusion par les différentes couches nuageuses  Lorsqu’il n’a pas été absorbé, le rayonnement global arrive au sol en observant deux types de trajectoire possibles :
Lorsqu’il n’a pas été absorbé, le rayonnement global arrive au sol en observant deux types de trajectoire possibles :
• celle du rayonnement direct, où le parcours des rayons est celui d’une droite unique entre le soleil et notre planète ;
• celle du rayonnement diffus, où le parcours des rayons est modifié par une succession d’obstacles : d’une part, les gouttelettes et cristaux de glace inclus dans les nuages, et d’autre part, les aérosols et les molécules d’azote et d’oxygène.
Les molécules constituant l’air atmosphérique diffusent d’autant plus fortement les rayons lumineux que ceux-ci ont une plus faible longueur d’onde : c’est pour cette raison que par temps clair (sans nuages), le ciel apparaît bleu ; de même, les rayons ultraviolets sont fortement diffusés par l’air, et le rayonnement UV global arrivant au sol est un rayonnement diffus à proportion de 50 à 80 %.
 Les différentes couches nuageuses diffusent elles aussi la lumière, mais de façon indifférente à la valeur de la longueur d’onde. Cela n’en signifie pas moins qu’elles accentuent la diffusion des rayonnements UV, de même que celle des autres rayons lumineux : Ainsi, la présence de nuages n’induit pas systématiquement une diminution du risque présenté par l’exposition aux ultraviolets, contrairement à ce que nous serions spontanément enclins à penser ; quant à la sensation de rafraîchissement que nous éprouvons lorsque le temps est nuageux, elle vient de ce que les nuages absorbent les infrarouges et n’a pas de rapport avec l’interaction entre nuages et ultraviolets. Il est vrai cependant que le rayonnement global, lorsqu’il rencontre des nuages en traversant la troposphère, est en partie diffusé en retour vers le haut, ce qui entraîne une baisse d’intensité du rayonnement arrivant au sol par rapport au rayonnement initial. De ce point de vue, d’ailleurs, toutes les catégories de nuages n’ont pas le même comportement. De façon générale, les nuages bas réduisent fortement le rayonnement, tandis que les nuages élevés (proches de la limite supérieure de la troposphère) en laissent passer la majeure partie.
Les différentes couches nuageuses diffusent elles aussi la lumière, mais de façon indifférente à la valeur de la longueur d’onde. Cela n’en signifie pas moins qu’elles accentuent la diffusion des rayonnements UV, de même que celle des autres rayons lumineux : Ainsi, la présence de nuages n’induit pas systématiquement une diminution du risque présenté par l’exposition aux ultraviolets, contrairement à ce que nous serions spontanément enclins à penser ; quant à la sensation de rafraîchissement que nous éprouvons lorsque le temps est nuageux, elle vient de ce que les nuages absorbent les infrarouges et n’a pas de rapport avec l’interaction entre nuages et ultraviolets. Il est vrai cependant que le rayonnement global, lorsqu’il rencontre des nuages en traversant la troposphère, est en partie diffusé en retour vers le haut, ce qui entraîne une baisse d’intensité du rayonnement arrivant au sol par rapport au rayonnement initial. De ce point de vue, d’ailleurs, toutes les catégories de nuages n’ont pas le même comportement. De façon générale, les nuages bas réduisent fortement le rayonnement, tandis que les nuages élevés (proches de la limite supérieure de la troposphère) en laissent passer la majeure partie. Pour un ciel peu nuageux, donc comportant quelques nuages épars ou bien seulement des nuages élevés tels que des cirrus ou un cirrostratus, on estime à 80 %, voire 90 %, la part du rayonnement UV qui atteint la surface de la Terre. Ainsi, les nuages élevés augmentent paradoxalement le risque de coups de soleil, du moins quand leur présence, comme pour les autres nuages, incite à négliger de se protéger.
Pour un ciel peu nuageux, donc comportant quelques nuages épars ou bien seulement des nuages élevés tels que des cirrus ou un cirrostratus, on estime à 80 %, voire 90 %, la part du rayonnement UV qui atteint la surface de la Terre. Ainsi, les nuages élevés augmentent paradoxalement le risque de coups de soleil, du moins quand leur présence, comme pour les autres nuages, incite à négliger de se protéger. D’autre part, la nébulosité agit sur le rayonnement direct : par suite, plus le ciel est nuageux, plus le rayonnement UV est faible, jusqu’à atteindre un minimum pour un ciel couvert.
D’autre part, la nébulosité agit sur le rayonnement direct : par suite, plus le ciel est nuageux, plus le rayonnement UV est faible, jusqu’à atteindre un minimum pour un ciel couvert.
En France, le premier département à être touché par les cancers de la peau est le Finistère, avec pourtant ses nuages assez fréquents et ses températures rarement excessives, mais aussi avec ses habitudes culturelles moins vigilantes que dans des régions plus méridionales, par exemple, face aux risques solaires.
La position du soleil
« Si vous apercevez un géant, regardez d’abord la position du soleil et voyez si le géant n’est pas l’ombre d’un pygmée » (poème allemand)
Les ultraviolets sont filtrés par l’atmosphère : de ce fait, plus leur traversée est longue, plus le taux d’UV arrivant au sol est faible ; ce taux doit donc se modifier, toutes choses égales d’ailleurs, en fonction de l’angle d’incidence du rayonnement solaire par rapport à la Terre, dont dépend la distance entre le haut de l’atmosphère et la surface terrestre.
Ainsi, le taux de rayonnement UV va varier :
• au long de la journée : son maximum est atteint au moment du midi solaire, là où le soleil est au plus haut dans le ciel, le parcours à travers l’atmosphère étant alors le plus court. Par rapport à ce moment, la trajectoire des rayons solaires est plus oblique le matin comme le soir, et la traversée de l’atmosphère est alors plus longue, d’où un rayonnement UV plus faible.
• avec les saisons : en été, les journées sont plus longues et le soleil « plus haut » qu’en hiver, où le rayonnement solaire est moins important.
• avec la position géographique : le rayonnement solaire varie en fonction de la latitude ; il est plus « rasant » aux hautes latitudes, jusqu’à disparaître durant l’hiver polaire.
• avec l’altitude : lorsque celle-ci augmente, le parcours des rayons diminue, et il en va de même pour leurs possibilités de filtrage ; en outre, la diffusion vers le haut s’accentue. On estime ainsi que le taux de rayonnement UV est  augmenté de 5 % à 1 000 m d’altitude, de 10 % à 2 000 m d’altitude et de 14 % à 3 000 m d’altitude. (Certaines études scientifiques traitent des risques que présentent les ultraviolets pour la santé des pilotes d’avions de ligne volant aux alentours de 10 000 mètres.)
augmenté de 5 % à 1 000 m d’altitude, de 10 % à 2 000 m d’altitude et de 14 % à 3 000 m d’altitude. (Certaines études scientifiques traitent des risques que présentent les ultraviolets pour la santé des pilotes d’avions de ligne volant aux alentours de 10 000 mètres.)
La réflexion par la surface terrestre
La surface terrestre interagit avec le rayonnement solaire : elle absorbe une part de ce rayonnement et en réfléchit l’autre part. Afin de mesurer cette autre part, on définit une quantité appelée l’albédo, qui est une fraction comprise entre 0 et 1 : à un instant donné et en un lieu donné de la surface terrestre, l’albédo est le taux de rayonnement réfléchi par cette surface, divisé par le taux de rayonnement qui y parvient dans le même domaine de longueurs d’onde. Plaçons-nous dans le domaine des ondes lumineuses. Plus l’albédo est élevé, plus fort est le taux de rayonnement réfléchi par la surface qu’il caractérise et plus grande est alors la quantité d’UV absorbée par l’organisme. Par exemple, la valeur de l’albédo pour la neige fraîche est de l’ordre de 0,8 à 0,9 : c’est dire que les capacités de réflexion maximale se rencontrent sur les surfaces enneigées et que les mesures de protection contre les UV, comme le montre cet exemple, doivent prendre en compte la réflexion au sol.
Plaçons-nous dans le domaine des ondes lumineuses. Plus l’albédo est élevé, plus fort est le taux de rayonnement réfléchi par la surface qu’il caractérise et plus grande est alors la quantité d’UV absorbée par l’organisme. Par exemple, la valeur de l’albédo pour la neige fraîche est de l’ordre de 0,8 à 0,9 : c’est dire que les capacités de réflexion maximale se rencontrent sur les surfaces enneigées et que les mesures de protection contre les UV, comme le montre cet exemple, doivent prendre en compte la réflexion au sol.
 Le rayonnement solaire, nous l’avons vu, entretient la biosphère et est vital pour l’organisme. Un équilibre est donc à trouver entre notre nécessaire ouverture aux effets bénéfiques de ce rayonnement et une attitude parfois inadaptée face à son action.
Le rayonnement solaire, nous l’avons vu, entretient la biosphère et est vital pour l’organisme. Un équilibre est donc à trouver entre notre nécessaire ouverture aux effets bénéfiques de ce rayonnement et une attitude parfois inadaptée face à son action.
En particulier, l’évolution des modes et des coutumes pousse nombre de personnes à la pratique du bronzage, devenu de nos jours un symbole de situations positives telles que vacances, séduction, réussite sociale… Il n’est guère besoin de rappeler l’étendue et l’universalité de ce symbole dans les sociétés modernes, sinon pour en souligner certains prolongements techniques, comme les tables à bronzer ou les crèmes auto-bronzantes. Or, le bien-être que nous procure le soleil ne provient pas du bronzage – qui constitue en fait une réaction de la peau contre les attaques des ultraviolets –, mais est dû à la lumière visible et à ses effets physiologiques, voire psychologiques. Cependant, un rôle bénéfique est incontestablement dévolu aux rayons ultraviolets. En effet, un élément chimique, le calcium, prend une part essentielle au développement continu de notre architecture osseuse. Or, le métabolisme et la concentration sanguine de cet élément sont régulés par la vitamine D, appelée aussi calciférol, et pour que cette vitamine puisse être synthétisée (à partir de divers acides gras), il est nécessaire que le corps soit soumis à l’action des UV-B : c’est pourquoi l’on attribue le surnom de « vitamine du soleil » à la vitamine D, qui permet entre autres de lutter contre le rachitisme chez les enfants et l’ostéoporose chez les personnes âgées. L’action des rayonnements solaires UV représente donc bien un besoin vital pour notre corps, à petite dose toutefois : un quart d’heure d’exposition par jour sur une petite surface de peau – sur les mains, par exemple – suffit pour engager le processus de synthèse de cette vitamine indispensable à l’organisme.
Cependant, un rôle bénéfique est incontestablement dévolu aux rayons ultraviolets. En effet, un élément chimique, le calcium, prend une part essentielle au développement continu de notre architecture osseuse. Or, le métabolisme et la concentration sanguine de cet élément sont régulés par la vitamine D, appelée aussi calciférol, et pour que cette vitamine puisse être synthétisée (à partir de divers acides gras), il est nécessaire que le corps soit soumis à l’action des UV-B : c’est pourquoi l’on attribue le surnom de « vitamine du soleil » à la vitamine D, qui permet entre autres de lutter contre le rachitisme chez les enfants et l’ostéoporose chez les personnes âgées. L’action des rayonnements solaires UV représente donc bien un besoin vital pour notre corps, à petite dose toutefois : un quart d’heure d’exposition par jour sur une petite surface de peau – sur les mains, par exemple – suffit pour engager le processus de synthèse de cette vitamine indispensable à l’organisme.
Notons que les UV peuvent aussi être employés pour soigner certaines maladies de peau, comme le psoriasis. Ils sont alors prescrits uniquement sous ordonnance médicale : c’est l’UV-thérapie.
Les dangers que suscitent les rayonnements ultraviolets pour notre organisme sont de nature diverse : les UV touchent à la fois la peau, les yeux, l’ensemble des défenses immunitaires… ; de plus, leurs actions peuvent se manifester à court terme ou à long terme.
Quelques chiffres
Deux ou trois chiffres suffiront à démontrer l’ampleur de ce « danger solaire ». Tout d’abord, les mélanomes, en France, sont la première cause de décès parmi les femmes dont l’âge est compris entre 25 et 35 ans. D’autre part, selon un sondage BVA, 88 % des Français sont conscients qu’un risque de cancer de la peau est lié à l’exposition solaire, mais uniquement 19 % des Français estiment qu’à ce sujet ils n’ont pas un comportement à risque.
Le mode d’action des UV-A et B
Les UV-A et les UV-B ne sont pas absorbés de la même manière par le corps humain : en effet, plus l’énergie d’un rayonnement est faible et plus la pénétration de celui-ci au sein de l’organisme est profonde. De la sorte, les UV-B sont absorbés très rapidement par l’épiderme tandis que les UV-A parviennent jusqu’au derme.
Les modes d’action des deux types de rayonnement sont également différents : les UV-B agissent directement sur l’ADN tandis que les UV-A agissent par l’intermédiaire de substances chimiques appelées radicaux libres ; ce sont ces substances qui, alors, attaquent l’ADN. Les UV-A comme les UV-B sont appelées des radiations génotoxiques, car dans les deux cas, ces rayonnements modifient le génome humain en réalisant des mutations au sein de l’ADN.
Enfin, la sensibilité aux UV diffère selon les types de peau, ce qui se traduit par des conséquences très distinctes en fonction de ces types, aussi bien en termes de coups de soleil, de brûlures ou de vieillissement que de cancers.
Les risques cutanés
Pour combattre l’action des UV, la peau sécrète un pigment, la mélanine, grâce à des cellules appelées mélanocytes : c’est ce phénomène que l’on qualifie couramment de bronzage. Les molécules de mélanine sont capables d’absorber une part plus ou moins grande des rayons UV-B incidents, mais jamais la totalité de ceux-ci ; il reste donc un danger pour la peau qui se traduit par de nombreux effets, que nous allons maintenant passer en revue.
Les coups de soleil Le premier effet produit par les ultraviolets devient visible quelques heures après l’exposition : c’est l’apparition de coups de soleil, ou érythèmes solaires.
Le premier effet produit par les ultraviolets devient visible quelques heures après l’exposition : c’est l’apparition de coups de soleil, ou érythèmes solaires.
Lorsque les UV-B agissent en faible dose sur la couche superficielle de la peau, il s’ensuit un épaississement de l’épiderme qui permet alors au corps de se protéger contre les agressions courantes de l’environnement. Mais si la dose d’UV-B est trop élevée, un rougissement de la peau apparaît, indiquant la formation d’une brûlure plus ou moins superficielle et étendue. Puis, si les dégâts génétiques sont trop importants, ils aboutissent à la mort programmée ou « apoptose » d’un plus ou moins grand nombre de cellules, qualifiées de Sun burn cells : c’est le coup de soleil. Un érythème peut se matérialiser aussi par une brûlure plus conséquente, avec apparition de cloques. De plus, l’accumulation de coups de soleil favorise l’apparition de cancers cutanés, car les cellules lésées par les UV-B ne sont plus réparées ni éliminées, de sorte que les lésions s’accumulent alors avec le temps.
Un érythème peut se matérialiser aussi par une brûlure plus conséquente, avec apparition de cloques. De plus, l’accumulation de coups de soleil favorise l’apparition de cancers cutanés, car les cellules lésées par les UV-B ne sont plus réparées ni éliminées, de sorte que les lésions s’accumulent alors avec le temps.
Les allergies solaires
Les allergies solaires se manifestent sous forme de rougeurs, ou bien de boutons ou d’urticaire ; elles peuvent être induites par certains parfums ou produits cosmétiques. La consultation du médecin est alors nécessaire.
Le vieillissement Une peau âgée se différencie d’une peau jeune par des rides nombreuses et par des troubles de la pigmentation. Les UV-A favorisent ce phénomène en déstructurant le réseau de fibres constitué à partir de certaines protéines – le collagène, l’élastine – et qui permet l’élasticité de la peau : c’est le phénomène du photo-vieillissement, qui se manifeste également par l’apparition de taches de rousseur et de ridules ainsi que par la dilatation des capillaires sanguins.
Une peau âgée se différencie d’une peau jeune par des rides nombreuses et par des troubles de la pigmentation. Les UV-A favorisent ce phénomène en déstructurant le réseau de fibres constitué à partir de certaines protéines – le collagène, l’élastine – et qui permet l’élasticité de la peau : c’est le phénomène du photo-vieillissement, qui se manifeste également par l’apparition de taches de rousseur et de ridules ainsi que par la dilatation des capillaires sanguins.
Les maladies cutanées photosensibles
Certaines maladies de peau, ou dermatoses, sont aggravées par l’exposition aux UV et en particulier aux UV-B : il en est ainsi de l’herpès, de l’acné et du mélasma, cette dernière affection étant observée en particulier chez les femmes enceintes ou sous contraception orale. Dans le cas de l’acné, des poussées apparaissent dans un délai de quinze jours à trois semaines après la fin de l’exposition aux UV, car l’épaississement de l’épiderme, en bouchant les pores de la peau, entraîne de nouvelles réactions inflammatoires.
Les maladies précédentes sont photo-aggravées. Mais certaines dermatoses peuvent être aussi photosensibles, soit par défaut de protection d’un système immunitaire affaibli sous l’action des UV – c’est par exemple le cas du vitiligo –, soit par manifestation d’une anomalie métabolique – c’est par exemple le cas des porphyries cutanées.
Les cancers de la peau Nos cellules sont dotées de systèmes de « réparation » en cas de lésions de l’ADN. Mais quand celles-ci deviennent trop nombreuses, elles se cumulent au cours du temps et ces systèmes de réparation ne peuvent plus y faire face. Dans ce type d’état, les lésions non réparées entraînent soit la mort des cellules par apoptose – c’est le cas des coups de soleil –, soit certaines mutations au sein du génome : les cellules mutées peuvent alors se développer de manière anarchique, entraînant l’apparition d’un cancer.
Nos cellules sont dotées de systèmes de « réparation » en cas de lésions de l’ADN. Mais quand celles-ci deviennent trop nombreuses, elles se cumulent au cours du temps et ces systèmes de réparation ne peuvent plus y faire face. Dans ce type d’état, les lésions non réparées entraînent soit la mort des cellules par apoptose – c’est le cas des coups de soleil –, soit certaines mutations au sein du génome : les cellules mutées peuvent alors se développer de manière anarchique, entraînant l’apparition d’un cancer.
On distingue deux types de cancers de la peau :
• les épithéliomas ou carcinomes, qui sont dus à l’altération des cellules de l’épiderme ;
• les mélanomes, qui sont dus à l’altération des cellules fabriquant les mélanines (ce sont les pigments qui, nous l’avons noté plus haut, interviennent dans la protection contre les UV en provoquant le bronzage).
Les épithéliomas sont les cancers les plus nombreux, à hauteur de 90 % des cas, et sont classés suivant deux types différents :
• les carcinomes basocellulaires, qui sont des tumeurs bénignes. Ils ne forment pas de métastases et peuvent être soignés par traitement chirurgical ;
• les carcinomes spinocellulaires, qui peuvent se métastaser et provoquer des cancers beaucoup plus dangereux. Ils se développent à partir de kératoses solaires (les kératoses sont des épaississements de la couche cornée de l’épiderme).
Les mélanomes sont des accumulations de cellules fabriquant des mélanines. Un mélanome se développe souvent à partir d’un grain de beauté.
Le mélanome est le cancer le plus mortel, même s’il est le cancer le moins fréquent (à hauteur de 10 % des cas). Il est aussi celui qui progresse le plus rapidement dans le corps. Aujourd’hui, il tue une fois sur cinq.
Pourtant, les mélanomes se soignent très bien pourvu qu’ils soient dépistés à temps : il suffit de rester attentif à l’apparition de boutons noirs sur la peau. Pour reconnaître un mélanome, on utilise le dépistage ABCDE :
• A pour asymétrie. La lésion est asymétrique ;
• B pour bord. Le contour est irrégulier ;
• C pour couleur. La lésion est polychrome ;
• D pour dimension. Le diamètre est supérieur à 8 mm ;
• E pour évolution. La lésion évolue (taille, couleur, rugosité, apparition de saignements…).
Les risques oculaires
« Le soleil a toujours blessé les yeux de ses adorateurs » (Louis Aragon)
Les UV pénètrent facilement à l’intérieur de l’œil, engendrant des lésions qui peuvent être irréversibles.
Les photokératites
Les affections inflammatoires de l’œil s’appellent les ophtalmies, et les kératites sont des ophtalmies de la cornée. Une photokératite sera donc un « coup de soleil de la cornée », celle-ci devenant enflammée ; il s’agit d’une lésion réversible. La photokératite la plus spectaculaire est l’ophtalmie des neiges.
La cataracte
Cette affection de l’œil est la première cause de cécité dans le monde. Les UV peuvent la favoriser ou la susciter en agissant sur le cristallin, qu’ils opacifient : la vue devient alors de plus en plus basse, jusqu’à ce que survienne la cécité complète. Pour rétablir la vue, l’opération la plus fréquente consiste à remplacer le cristallin : on compte actuellement 400 000 cas par an d’opérations de ce type en France, et ce nombre va croissant.
Les risques immunitaires  Les ultraviolets détériorent le système immunitaire. Un exemple de cette dégradation est fourni par l’effet inhibiteur des UV sur la traduction de certains gènes : or, ces gènes sont responsables de la synthèse de protéines qui participent à une protection immunitaire naturelle, à savoir, l’élimination des cellules mutées. Sans la présence de telles protéines, le système immunitaire ne peut plus assurer sa fonction de protection contre les cancers : c’est là l’origine de certains cancers cutanés que nous venons d’évoquer.
Les ultraviolets détériorent le système immunitaire. Un exemple de cette dégradation est fourni par l’effet inhibiteur des UV sur la traduction de certains gènes : or, ces gènes sont responsables de la synthèse de protéines qui participent à une protection immunitaire naturelle, à savoir, l’élimination des cellules mutées. Sans la présence de telles protéines, le système immunitaire ne peut plus assurer sa fonction de protection contre les cancers : c’est là l’origine de certains cancers cutanés que nous venons d’évoquer. Un autre exemple majeur de déficience immunitaire est lié à la médecine préventive : en effet, la surexposition aux UV peut diminuer fortement l’efficacité des vaccins administrés par voie cutanée, comme il est apparu lors de campagnes de vaccination menées par l’OMS en Afrique.
Un autre exemple majeur de déficience immunitaire est lié à la médecine préventive : en effet, la surexposition aux UV peut diminuer fortement l’efficacité des vaccins administrés par voie cutanée, comme il est apparu lors de campagnes de vaccination menées par l’OMS en Afrique.
Pour protéger les populations des risques que leur font courir les effets nocifs des ultraviolets, l’OMM et l’OMS ont établi et recommandent en commun une échelle d’évaluation dont l’unité, appelée l’index UV, représente le danger potentiellement associé au rayonnement ultraviolet arrivant au sol. Cet index prend des valeurs comprises entre 0 et 20, qui vont croissant avec le risque sanitaire, et il est calculé sur le spectre de longueurs d’onde qui va de 250 à 400 nm : il intègre suivant ce spectre l’effet d’une grandeur physique – le taux d’ultraviolets arrivant au sol –, pondéré par un coefficient qui est une grandeur biologique représentant la capacité d’action inflammatoire des UV en fonction du créneau de longueurs d’onde considéré.
L’index UV
Pour qualifier de façon parlante les valeurs pouvant être prises par l’index UV, on les répartit suivant 5 classes de risque regroupant les valeurs qui vont de 0 à 2 inclus, puis de 2 à 4, de 4 à 6, de 6 à 8, et qui enfin dépassent 8 (les valeurs au-delà de 10 sont déjà rares) :

risque faible

risque modéré

risque élevé

risque fort

risque extrême
Conseils santé
« Le soleil n’échauffe que ce qu’il voit » (proverbe français)
La barrière mélanique offerte par le bronzage nous apporte une protection superficielle face aux UV ; mais elle en absorbe, au grand maximum, 90 %. Une protection complémentaire apparaît donc indispensable ; cependant, l’ampleur de cette protection seconde n’est pas identique pour toutes les personnes, même si elle fait appel à des consignes qui, elles, sont communes à tous : tout d’abord, éviter les heures d’ensoleillement maximum, puis privilégier la protection vestimentaire, le port d’un chapeau et celui de lunettes, et en dernier lieu, appliquer des produits solaires.
L’âge
La peau des enfants est beaucoup plus sensible aux ultraviolets que celle des adultes, du fait de l’immaturité de son système immunitaire ; ainsi, chaque coup de soleil subi durant l’enfance accentue la prédisposition au cancer à l’âge adulte. Rappelons-nous que les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas être exposés au soleil.
Les activités à risque
L’exposition aux ultraviolets est particulièrement élevée à l’occasion des vacances ou des loisirs. De plus, certains sports, certaines activités de loisirs présentent des risques plus importants : tel est le cas de la voile ou de la haute montagne, qui livrent le corps à la réverbération des rayons solaires. Mais le danger est également présent lors des séances de jardinage et plus généralement chez les milieux professionnels où le travail s’opère souvent en extérieur : les mesures de protection ne doivent donc pas être oubliées pour les cultivateurs, les jardiniers, les travailleurs du bâtiment et des ponts et chaussées, les agents de circulation, les marins…
Les différents types de peau
Chacun de nous possède un « capital soleil » différent ; lorsque ce capital d’exposition est dépassé, le risque de cancer devient élevé. Pour matérialiser et hiérarchiser ces différences de sensibilité au risque solaire selon les individus, on a défini 6 classes de photosensibilité de la peau, déterminées d’après la répartition et les caractéristiques des mélanocytes et appelées « types de peau » ou « phototypes » :
Type I : peau claire qualifiée de « laiteuse », cheveux roux, nombreuses taches de rousseur. Les personnes de ce type ne bronzent jamais, mais attrapent des coups de soleil en une dizaine de minutes en moyenne.
Type II : peau claire, cheveux blonds, peu de taches de rousseur. Les personnes de ce type bronzent légèrement, mais sont très rapidement sujettes aux coups de soleil.
Type III : peau claire, cheveux châtains, pas de taches de rousseur. Les personnes de ce type ont une tendance fréquente aux coups de soleil et bronzent sous forme de hâle clair.
Type IV : peau mate, cheveux bruns. Les personnes de ce type ne sont que rarement sujettes aux coups de soleil ; elles bronzent très facilement et présentent un bronzage foncé.
Type V : peau mate, cheveux très bruns. Les personnes de ce type ne prennent qu’exceptionnellement des coups de soleil et leur bronzage est très foncé.
Type VI : peau et cheveux noirs. Les personnes de ce type n’attrapent jamais de coups de soleil et ont un bronzage noir.
Choisir sa crème solaire : les indices
Aucune crème solaire ne filtre en totalité les ultraviolets, de sorte que le risque zéro n’existe pas non plus avec ce moyen : si nous pouvons utiliser une crème solaire pour limiter les méfaits des ultraviolets, son emploi ne doit pas nous inciter pour autant à rester trop longtemps au soleil. Du reste, l’efficacité d’une crème dépend essentiellement de la manière dont on l’utilise : elle doit être renouvelée toutes les deux heures environ, voire toutes les demi-heures lorsqu’il y a exposition à la neige.
Choisir une crème solaire revient à choisir un facteur de protection solaire (en abrégé FPS), encore appelé un indice de protection (en abrégé IP) :
• Le FPS exprime une capacité de protection contre les UV.
• Chacun doit déterminer son choix de crème conformément à son type de peau et à l’index UV du jour où il l’applique. En cas de doute, mieux vaut prendre une crème d’indice 25 au minimum, car un FPS égal ou supérieur à 25 signifie la garantie d’obtenir une protection satisfaisante contre les UV-A et B.
• Il existe des crèmes résistantes à l’eau. Il est préférable de choisir de telles crèmes, à condition de bien réitérer leur application après chaque baignade.
• Certaines zones du corps sont plus sensibles que d’autres à l’action des UV : une crème est à appliquer fréquemment sur les oreilles, le nez, les lèvres et la nuque.
Choisir ses lunettes de soleil
Certaines lunettes de soleil ne protègent que de l’éblouissement. Il faut vérifier que les lunettes utilisées portent l’une des mentions CE 3 ou CE 4, qui garantissent la protection contre les UV-A et B.
Interpréter l’index UV
La protection nécessaire contre l’exposition aux ultraviolets est déterminée en fonction de l’index UV et du phototype :
• les types I, II, III sont appelés sensibles ;
• les types IV, V, VI sont appelés normaux.
Attention, toutefois : les enfants jusqu’à 15 ans ont une peau considérée comme sensible quel que soit leur phototype.
Recensons maintenant les catégories de protection, qualifiées de façon identique aux risques :
• Index UV 1 et 2 : FAIBLE
Ces valeurs de l’index n’appellent pas de protection particulière, quoique le port de lunettes de soleil demeure conseillé.
• Index UV 3 et 4 : MODÉRÉE
Pour les peaux sensibles, il est conseillé de porter lunettes et chapeau et d’appliquer une crème FPS 15. Pour les peaux normales, une crème FPS 8 suffit.
• Index UV 5 et 6 : ÉLEVÉE
Il faut éviter l’exposition des jeunes enfants et, tant en ce qui concerne les peaux normales que les peaux sensibles, porter chapeau et lunettes. La crème sera d’indice FPS 25 pour les peaux sensibles, 15 pour les peaux normales.
• Index UV 7 et 8 : TRÈS FORTE
On doit éviter d’exposer les enfants entre 12 et 16 heures ; il faut aussi porter lunettes, chapeau et T-shirt et appliquer toutes les heures une crème d’indice FPS 40 pour les peaux sensibles, 25 pour les peaux normales.
• Index UV 9 et plus : EXTRÊME
Pour les peaux sensibles, il est conseillé de rester à l’intérieur. Sinon, on doit porter vêtements, chapeau à larges bords et lunettes de haute protection (comme les lunettes de glacier) ; une crème d’indice 40 est à appliquer régulièrement sur les parties du corps restant exposées.
Si vous ne connaissez pas l’index UV…
Regardez votre ombre : si elle est plus petite que vous, le risque est présent !
En bref
1. Faire preuve de bon sens.
2. Ne pas s’exposer aux risques inutiles.
3. Éviter l’exposition aux heures où le soleil est au plus haut, donc entre 12 et 16 heures.
4. Pour bronzer sans danger, porter des lunettes de soleil enveloppantes munies de verres anti-UV.
5. Porter un chapeau à larges bords.
6. Porter des vêtements.
7. Appliquer régulièrement une crème de haut indice (FPS 25 ou plus), sans pour autant augmenter la durée d’exposition du corps.
Les opinions erronées
1. Des gouttelettes d’eau sur le corps rafraîchissent la peau et donnent une fausse impression de sécurité : il faut donc se méfier de semblables sensations.
2. Certains nuages, en particulier les voiles nuageux d’altitude, laissent passer presque tous les UV alors qu’en même temps ils font baisser fortement la température et la luminosité : un moment où il fait moins chaud ne signifie pas un moment où il y a moins de risque.
3. Une peau n’est pas totalement protégée parce qu’elle est bronzée ; elle risque alors peu les coups de soleil, mais subit les dommages des UV-A.
4. Le bronzage artificiel ne prépare pas aux agressions des UV solaires : au contraire, la table à bronzer est plus dangereuse, car elle émet directement les UV ; ce type de bronzage est d’ailleurs interdit aux mineurs.
5. L’écran total n’existe pas : une crème solaire, même de haut indice, reste un filtre, donc un système qui, comme une passoire, retient la majorité des UV mais laisse passer une partie d’entre eux.
6. Le rayonnement UV n’arrive pas uniquement du ciel, mais aussi après réflexion par le sol ou par l’eau ; il est ainsi possible de bronzer sous un parasol…
7. Un indice de protection FPS élevé n’autorise pas pour autant à prolonger l’exposition du corps au soleil.