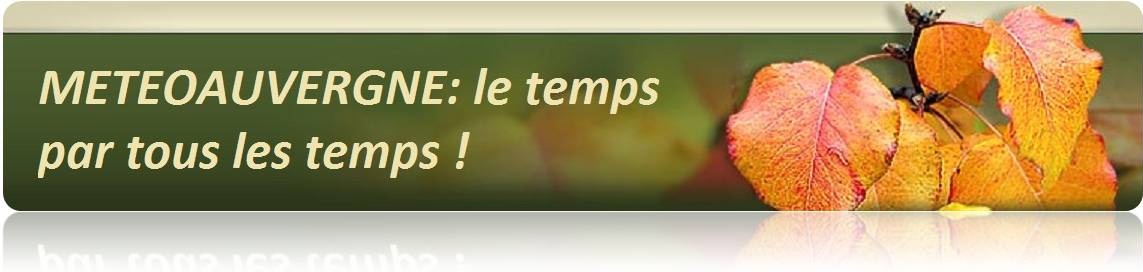

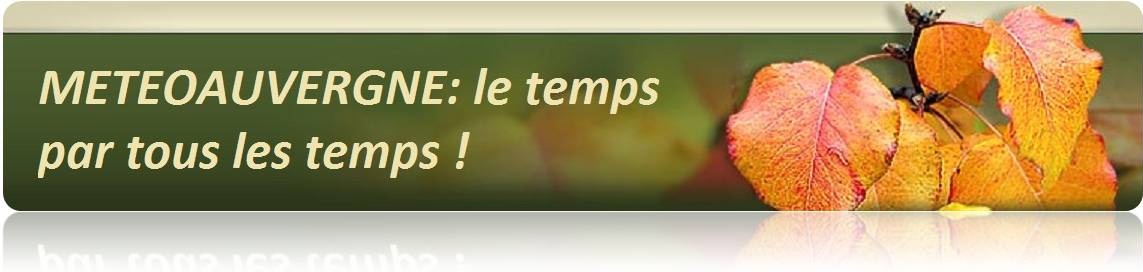

III- Les pollens
Introduction
La pollinose, souvent appelée rhume des foins, est le nom donné à l'allergie au pollen des arbres, plantes, herbacées et graminées. Elle est en général saisonnière et récidive chaque année à peu près à la même période.
Le rhume des foins touche 15 à 25 % de la population. Il apparaît le plus souvent entre 8 et 20 ans et diminue avec l'âge (10% des enfants d'âge scolaire et 15% des adolescents et des adultes jeunes). Après 35 ans, la révélation d'une pollinose est rare.
Le grain de pollen est l'élément reproducteur microscopique produit par les organes mâles des plantes (anthère des étamines). Sa taille varie de 5 à 250 micromètres. Le pollen joue ici le rôle d'allergène : il pénètre dans l’organisme par les voies respiratoires et provoque une réaction du système immunitaire.
Les pollens provoquent des affections d'apparence bénigne, parfois sévères, toujours gênantes voire invalidantes :
• des rhinites avec irritation et picotements du nez, crises d'éternuements, écoulement souvent abondant et obstruction nasale.
• des conjonctivites avec larmoiement, démangeaisons, rougeurs et sensation de grains de sable.
• toux, oppression thoracique ou respiration sifflante, asthme, avec diminution du souffle
• fatigue, maux de tête, manque de concentration ou d'attention lié à un sommeil perturbé par la rhinite
• manifestations cutanées avec aggravation de certains eczémas, plus rarement oedèmes et urticaires.
La météo joue un rôle déterminant dans le cycle des pollens : elle intervient dans le déclenchement de la pollinisation, la quantité de pollen produit et leur dispersion dans l’air.
Les principaux pollens allergisants
Tous les pollens ne sont pas allergisants. Pour provoquer des symptômes d’allergie, les grains des pollens doivent atteindre les muqueuses respiratoires de l’homme. Pour être allergisants, un grain de pollen doit disposer de substances (protéines ou glycoprotéines) reconnues comme immunologiquement néfastes pour un individu donné.
Les pollens les plus allergisants sont ceux transportés par le vent (issus des plantes dites « anémophiles ») et de très petite taille (de 20 à 60 micromètres en moyenne) qui se déposent sur les muqueuses de l'appareil respiratoire. Les fleurs qui utilisent le vent sont généralement discrètes, ternes, sans odeur ni nectar et unisexuées (graminées, oseille, armoise, ambroisie, cyprès, bouleau, etc.). Leur pollen est abondant dans l'atmosphère : un pin peut produire 6 à 7 milliards de grains par an, un pied d’ambroisie 2,5 milliards de grains sur une saison.
A l’initiative du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA), on classe en France les espèces selon un potentiel allergisant allant de 0 à 5 (0 étant un potentiel nul et 5 un potentiel très fort). Ce classement a été établi grâce à des capteurs de pollens et à l’intensité des symptômes observés chez les patients atteints de pollinose.
| Principaux pollens allergisants | |
| Espèces | Potentiel allergisant (0 = nul ; 5 = très fort) |
| Arbres | |
| Pin | 0 |
| Orme | 1 |
| Mûrier | 3 |
| Hêtre | 3 |
| Châtaignier | 2 |
| Noisetier | 3 |
| Peuplier | 3 |
| Saule | 3 |
| Frêne | 4 |
| Platane | 4 |
| Olivier | 3 |
| Tilleul | 3 |
| Aulne | 3 |
| Charme | 4 |
| Chêne | 4 |
| Bouleau | 5 |
| Cyprès | 5 |
| Herbacées | |
| Ortie | 1 |
| Oseille | 2 |
| Plantain | 3 |
| Chenopode | 3 |
| Pariétaire | 4 |
| Armoise | 4 |
| Ambroisie | 5 |
| Graminées (phlélole, ivraie, dactyle, paturin) | 5 |
Les saisons de pollinisation
La pollinisation hivernale a lieu en France de mi-janvier à mars-avril pour le sud et de fin janvier à avril-mai pour le nord. Elle concerne les arbres et arbustes. Les essences diffèrent selon les régions :
• bouleau et frêne dans toute la France sauf sur le pourtour méditerranéen,
• platane, chêne et noisetier dans toute la France,
• olivier et cyprès dans le midi aquitain et méditerranéen.
Une deuxième période de pollinisation se produit du milieu du printemps à l’été avec un décalage de 3 à 5 semaines entre le sud et le nord du pays. C’est la saison des graminées, du plantain, des pariétaires sur le pourtour méditerranéen et de l’oseille dans le nord.
De nombreuses espèces végétales libèrent leur pollen de l’été jusqu’à la fin de l’automne : le châtaignier, le tilleul, les herbacées et l’ambroisie.
En montagne, la saison pollinique est plus courte qu’en plaine et la quantité de pollen émise plus faible.
Les saisons de pollinisation varient selon les espèces végétales, les régions, et les années. Elles sont de plus tributaires des conditions météorologiques.
Facteurs climatologiques
La température
Un hiver doux accélère le développement des plantes et déclenche une pollinisation précoce.
Exemple : l’hiver 1987-1988
Sur une grande région nord de la France, les températures moyennes ont été supérieures aux normales saisonnières dès la mi-décembre 1987 et cette douceur s’est poursuivie jusqu’en février 1988. Début 1988, la pollinisation a été avancée de 4 à 6 semaines par rapport à la normale.
En revanche, un hiver froid accompagné d’épisodes de gel retarde la croissance de la plante et le début de la pollinisation.
Exemple : l’hiver 2002-2003
Le froid subit en janvier et février 2003 a retardé de 6 semaines la libération des pollens de certains arbres précoces calés sur le 20 janvier, comme le noisetier.
Dès que la température s’est adoucie, la pollinisation a redémarré. Les pollens se sont dispersés en 2 semaines au lieu de 6, augmentant du coup le risque allergique par une concentration plus importante.
Une forte amplitude thermique au cours de la journée contribue à la libération des grains de pollen. En période de floraison, des températures élevées favorisent les fortes concentrations de pollen dans l’air ambiant.
L’ensoleillement
Un bon ensoleillement est nécessaire à la plante pour se développer, surtout au stade du bourgeonnement. L’ensoleillement favorise le déclenchement précoce de la pollinisation et l’émission abondante de pollens jour après jour.
Un bon ensoleillement et des températures douces favorisent l’émission de pollen.
Facteurs météorologiques
Le vent
En période de pollinisation, le vent joue un rôle déterminant dans le transport des grains de pollen et la quantité de grains présents dans l’air que nous respirons.
Si le vent est faible (inférieur à 2 km/h) le dépôt du pollen au sol est presque immédiat et s’effectue à proximité de la plante. Un vent fort (supérieur à 43 km/h) peut emporter le pollen et le diluer dans l’atmosphère. Si le vent est modéré, il maintient les grains en suspension dans l’air et favorise leur concentration.
La nuit est moins favorable à l’émission des pollens et à leur dispersion car les vents produits par le réchauffement du sol en journée sont fortement atténués. De nuit ou par vent faible, les distances parcourues par le pollen sont en général réduites : il se dépose à proximité de la plante émettrice, surtout les grains les plus lourds.
Les précipitations et l’humidité de l’air
La pluie est nécessaire à la plante pendant ses phases de croissance et de floraison, mais elle empêche la libération des pollens et plus encore leur dispersion par le vent. Le pollen alourdi par la pluie se sédimente à faible distance de sa source.
Par temps pluvieux ou lorsque l’air est très humide (brume, brouillard, présence de rosée matinale), le taux pollinique de l’atmosphère est donc faible.
S’il pleut quelques jours pendant la saison pollinique, le pollen sera conservé par la plante puis relâché lorsque les conditions seront redevenues favorables.
Les personnes allergiques sont ainsi souvent soulagées par l’arrivée de la pluie.
Les situations orageuses
A l’approche d’un orage et à son passage, les vents brassent l’atmosphère et ses pollens qui sont ensuite rabattus au sol par les averses.
Les précipitations qui accompagnent les orages font également chuter les taux de pollens présents dans l’atmosphère.
La situation météo la plus favorable à la libération et à la dispersion des pollens est une journée très ensoleillée avec des températures élevées et un vent modéré, sans précipitations.
Changements climatiques et allergies
Les changement climatique planétaire en cours, présente des risques sanitaires notables que les scientifiques s’efforcent d’identifier, notamment dans le domaine des allergies respiratoires.
Les quantités de pollens émises devraient augmenter au cours des prochaines décennies et de nouvelles variétés de pollens pourraient atteindre des régions où elles ne sont pas encore connues.
Les simulations réalisées par les spécialistes du réchauffement climatique ( Lien vers rubrique climat) prévoient d’ici la fin du 21 ème siècle des hivers plus doux et des étés plus chauds sur nos régions. Ces conditions météorologiques favoriseraient des saisons polliniques plus précoces et plus longues.
De plus, l’augmentation de la quantité de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère permet aux plantes de produire davantage de pollens donc plus d’allergènes.
Dans les années 1900, (teneur en CO2 de 290 ppm), un pied d’ambroisie produisait 5,5 g de pollen. Aujourd’hui, (teneur en CO2 de 370 ppm), un pied en produit 10 g. Si la quantité de CO2 dans l’atmosphère augmente dans les mêmes proportions, chaque plante pourrait produire 20 g de pollen d’ici 100 ans.
Les allergies se déclenchent à partir d’une certaine quantité de pollens dans l’air, variable d’un individu à l’autre. Des personnes qui ne sont pas allergiques aux taux polliniques actuels pourraient l’être d’ici quelques années.
Pollen et pollution atmosphérique
Des études épidémiologiques récentes révèlent le lien entre la progression du nombre de pollinoses et la pollution atmosphérique.
Les polluants atmosphériques d’origine industrielle (dioxyde d’azote, dioxyde de soufre, ozone) modifient les pollens : la quantité d’allergènes présents dans un grain augmente et leur libération est facilitée par la détérioration de la paroi du grain. Les pollens pollués ont un potentiel allergisant beaucoup plus élevé.
La pollution atmosphérique produit une hyper réactivité bronchique et une irritation nasale et oculaire. Ces effets accroissent la sensibilité des personnes prédisposées aux pollinoses. Elles réagissent à des taux d’allergènes plus faibles du fait de leur fragilisation, et dans le même temps, peuvent être exposées à une concentration plus forte d’allergènes.