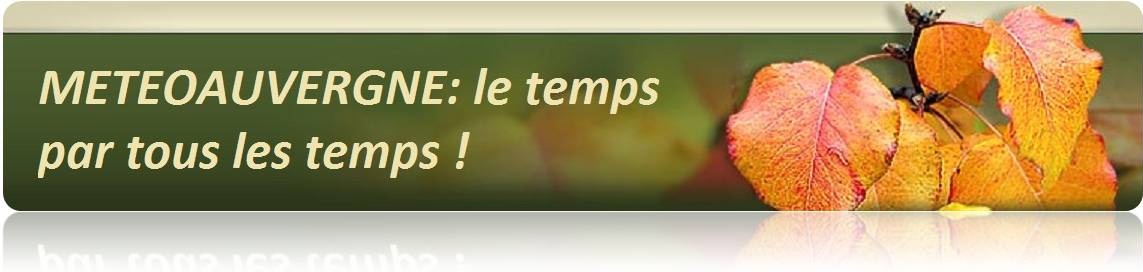

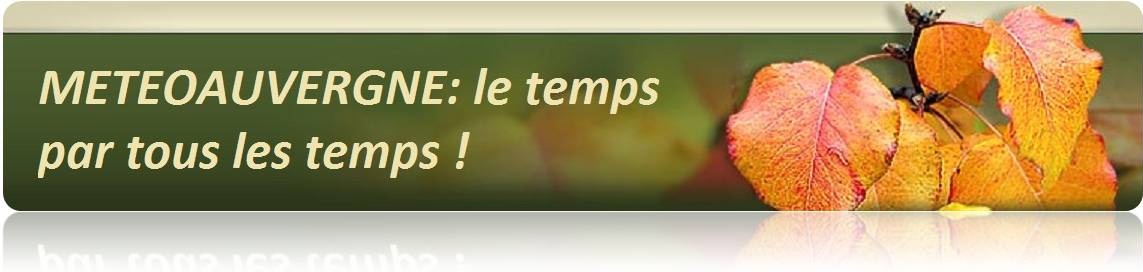

En météorologie, un nuage est une masse visible de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace en suspension dans l'atmosphère.
On parle aussi de nuages de fumées et de nuages de poussière, par analogie avec les formes que prennent les nuages atmosphériques (amas, filaments, volutes).
Toujours par analogie, on parle de nuages de sauterelles (déplacement de grands nombres de criquets et de nuages de points (regroupement de points sur des diagrammes mathématiques)).
Formation des nuages
La formation de nuages résulte du refroidissement d'un volume d'air jusqu'à la condensation d'une partie de sa vapeur d'eau. Si le processus de refroidissement se produit au sol (par contact avec une surface froide, par exemple), on assiste à la formation de brouillard. Dans l'atmosphère libre, le refroidissement se produit généralement par soulèvement, en vertu du comportement des gaz parfaits dans une atmosphère hydrostatique, selon lequel un gaz se refroidit spontanément lorsque la pression baisse. Inversement, la dissipation des nuages se produit lorsqu'un réchauffement permet aux gouttelettes ou aux cristaux de glace de s'évaporer. Les nuages peuvent aussi perdre une partie de leur masse sous forme de précipitations, par exemple sous forme de pluie, grêle ou neige.
La condensation de la vapeur d'eau, en eau liquide ou en glace, se produit initialement autour de certains types de micro-particules de matière solide (aérosols), qu'on appelle des noyaux de condensation ou de congélation. Il est à noter que la congélation spontanée de l'eau liquide en glace, dans une atmosphère très pure, ne se produit pas au-dessus de -40 °C. Entre 0 et -40 °C, les gouttes d'eau restent dans un état métastable (surfusion), qui cesse dès qu'elles rentrent en contact avec un noyau de condensation (poussière, cristal de glace, obstacle). Lorsque ce phénomène se produit au sol, on assiste à des brouillards givrants.
Juste après la condensation ou la congélation, les particules sont encore très petites. Pour des particules de cette taille, les collisions et l'agrégation ne peuvent pas être les facteurs principaux de croissance. Il se produit plutôt un phénomène connu sous le nom de processus de Bergeron. Ce mécanisme repose sur le fait que la pression partielle de saturation de la glace est inférieure à celle de l'eau liquide. Ceci signifie que, dans un milieu où coexistent des cristaux de glace et des gouttelettes d'eau surfondue, la vapeur d'eau ambiante se condensera en glace sur les cristaux de glace déjà existants, et que les gouttelettes d'eau s'évaporeront d'autant. On voit ainsi que le soulèvement est doublement important dans la formation de nuages et de précipitation : en premier lieu comme mécanisme de refroidissement, et ensuite comme porteur de gouttelettes d'eau liquide jusqu'au niveau où elles deviennent surfondues.
Le soulèvement peut être dû à la convection, à la présence de terrains montagneux faisant obstacle à l'écoulement de l'air ou à des facteurs de la dynamique atmosphérique, comme les ondes baroclines (aussi appelées ondes frontales).
Il existait au 19e siècle une classification compliquée des nuages en fonction de leur apparence qui faisait usage de termes en latin. Cette classification n'est plus utilisée en météorologie moderne, bien qu'il en reste des reliquats.
La nomenclature moderne divise les nuages en deux grands types : convectifs et stratiformes.
Les deux types de nuages (cumulus et stratus) sont divisisés en quatre groupes selon la hauteur de leur base (et non l'altitude de la cime). On qualifie le nuage élevé de cirrus et le nuage d'altitude moyenne d'altus. Il n'existe pas de préfixe pour les nuages bas. Ce système a été proposé en 1802 par Luke Howard.
Il se forment au dessus de 5000 mètres dans la région froide qu'est la troposphere. Ils sont classés en utilisant le prefix cirro- ou cirrus. À cette altitude, l'eau gèle quasiment toujours: les nuages sont donc composés de cristaux de glace.
Les nuages dans la famille A sont:
 Cirrus |
 Cirrocumulus |
 Cirrostratus |
Il se développent entre 2000 et 5000 mètres et sont classés en utilisant le prefix alto-. Ils sont formés de goutellettes d'eau.
Les nuages dans la famille B sont:
 Altostratus |
 Altocumulus |
 Nimbostratus |
Ce sont des nuages de basses altitudes (jusqu'à 2000 mètres) et inclus les stratus. Lorsque ces derniers rencontrent la terre, ont les appelle brouillard.
Les nuages dans la famille C sont:
 Stratocumulus |
 Stratus |
 Cumulus |
Ces nuages peuvent avoir de forts courants verticaux et s'élevent bien au dessus de leur base. Ils se forment à différentes altitudes.
Les nuages dans la famille D sont :
 Cumulonimbus |
 Cumulonimbus |
Quelques nuages peuvent être rencontrés dans la troposphère, stratosphère et mésosphère, comme les nuages noctulescents.
La diffusion de la lumière par les gouttelettes des nuages selon la théorie de Mie se fait surtout vers la direction d'où vient la lumière et dans la direction où elle va. Ainsi, la blancheur des nuages est maximale lorsque l'observateur dirige son regard dans un axe aligné avec le soleil, soit dans le dos ou devant lui. À tout autre angle, il reçoit seulement une fraction de la luminosité.
La dispersion de la lumière à travers les cristaux de glace des cirrostratus, obéit quant à elle à la diffusion de Rayleigh qui est isentrope selon l'angle mais dépend de la longueur d'onde. C'est pourquoi on voit souvent des halos circulaires autour du soleil lorsque ce type de nuage s'interpose.