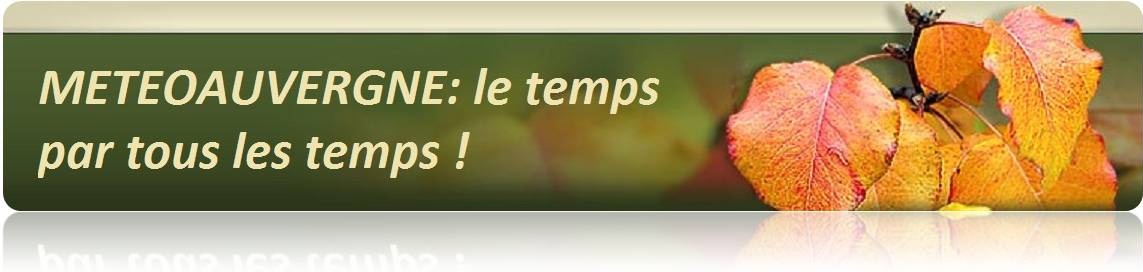

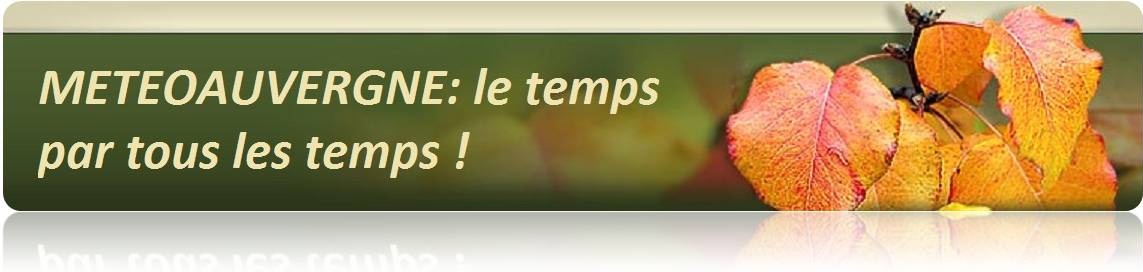

La neige
La neige est une forme de précipitation, constituée de glace cristallisée et agglomérée en flocons pouvant être ramifiés d'une infinité de façons. Puisque les flocons sont composés de petites particules, ils peuvent avoir aussi bien une structure ouverte et donc légère qu'un aspect plus compact voisin de celui de la grêle. La neige se forme généralement par la condensation de la vapeur d'eau dans les hautes couches de l'atmosphère et tombe ensuite plus ou moins vite à terre selon sa structure.
La neige peut être aussi fabriquée à l'aide de canons à neige, qui créent en réalité de minuscules grains proches de la neige fondue. Cette technique est utilisée dans les stations de sports d'hiver pour améliorer l'état de leurs pistes.

Dans un nuage très froid, la vapeur d'eau se condense directement en cristaux de glace sur des particules en suspension (poussières, fumée...). S'il ne rencontrent que des couches de température inférieure à 0°C dans leur chute, les cristaux s'agglutinent en forme de branches glacées qui se combinent pour former des flocons de plus en plus larges. L'assemblage de ces cristaux dépend essentiellement des températures. La seule caractéristique commune à tous les flocons est la structure hexagonale liée à l'angle de 120° de la molécule d'eau. Elle provient d'une minimisation de l'énergie potentielle du cristal.
La forme des flocons varie en fonction de la température :
La densité de la neige fraîchement tombée est très variable. Les statistiques donnent une moyenne de 110 kg par mètre cube, avec un écart type de 40 kg qui confirme le caractère dispersé de ce critère.
La formation et l'évolution des cristaux intègrent :
La faiblesse des liens des molécules d'eau rend tout cristal très sensible à toute modification de son environnement. On peut considérer le cristal de neige comme instable et qu'il doit être en phase de cristallisation pour conserver sa forme alors que des recombinaisons se produisent dès que celle-ci s'interrompt. Cette vive sensibilité rend difficile l'observation microscopique des cristaux sans précautions particulières.
La neige fraîchement tombée est sujette à l'action du vent, surtout si elle est très légère, comme la poudrerie des Québécois. Elle peut se concentrer en dunes nommées bancs de neige (Canada) ou congères (Europe). Ce n'est pas le cas de la neige de printemps, compacte et riche en eau, amenée à fondre sur place. En montagne, le vent est à l'origine de corniches qui peuvent piéger les randonneurs.
La neige n'est pas un matériau inerte. Elle est au contraire en constante évolution et ne cesse de se transformer, soumise à l'action de son propre poids qui la tasse, ainsi qu'aux différences de températures entre le jour et la nuit. Si la pente est raide, le manteau peut devenir instable et générer des avalanches.
Elle se déroule lorsque le gradient thermique au sein de la couche est faible, inférieur à 5°C par mètre. À cause des déséquilibres de vapeur saturante, les dendrites se detruisent au profit du centre du cristal. Les cristaux s'arrondissent et leur taille se calibre. On les appelle grains fins. Les contacts ainsi créés entre eux correspondent à la formation de ponts de glace qui soudent les cristaux les uns aux autres. C'est le phénomène de frittage. La couche de neige gagne en cohésion et en densité.
Elle apparaît quand le gradient thermique au sein de la couche est compris entre 5 et 20 °C par mètre. On observe également un transfert de matière par sublimation / congélation mais la direction privilégiée est la verticale, du bas vers le haut. Les cristaux se transforment en grains à face planes.
Lorsque le gradient thermique est supérieur à 20 °C par mètre, le flux de vapeur au sein de la couche de neige devient très fort. Après une dizaine de jours, il y a apparition de gobelets, ou givre de profondeur, qui peuvent atteindre plusieurs millimètres de diamètre. La manteau devient alors très instable, se trouvant sur un véritable roulement à billes.
Elle se traduit par l'apparition d'eau liquide au cœur du mateau neigeux. Elle est provoquée par un chute de pluie ou un redoux prolongé. Il se forme des agglomérats dits grains ronds ("gros sel") qui rendent le manteau neigeux très instable.
Expressions
La neige se retrouve dans plusieurs expressions :
Et par analogie :