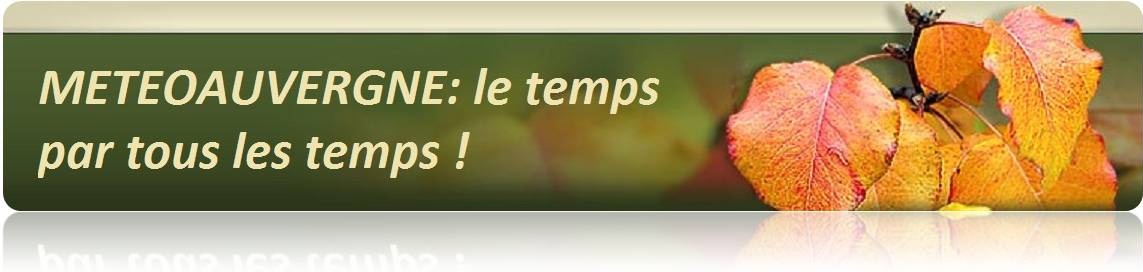

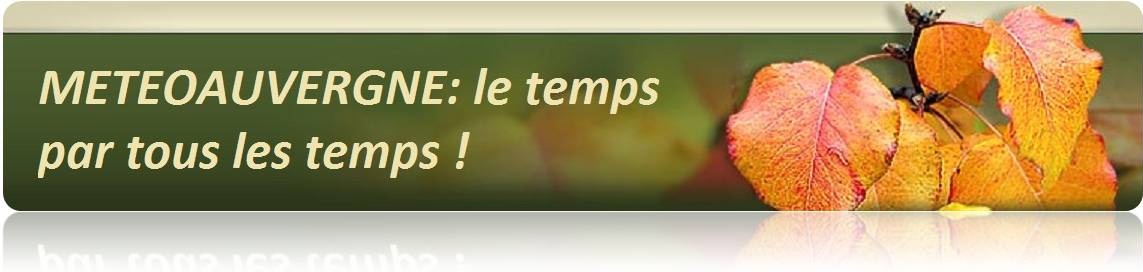

La grêle
La grêle est un type de précipitation qui résulte parfois d'orages particulièrement forts. Elle prend la forme de billes de glace (grêlons) dont le diamètre peut varier de quelques millimètres à une dizaine de centimètres.
Origine
Les grêlons croissent lorsque les gouttes de pluie contenues dans un orage sont soulevées par les forts courants ascendants qui caractérisent les orages. Ces gouttes peuvent geler alors qu'elles sont soumises aux températures sous le point de congélation mais également rester en surfusion jusqu'à -39°C, selon qu'elles contiennent ou non un noyau de condensation.
Dès qu'une goutte gèle, surtout dans les niveaux supérieurs de la troposphère où la température est sous -10°C, elle devient un tel noyau. La pression de vapeur de saturation de la glace étant moindre que celle de l'eau à des températures sous le point de congélation, les grêlons croissent plus rapidement que les gouttes dans une atmosphère humide comme l'orage. En plus, ils canibalisent la vapeur d'eau des gouttes surfondues dans leur entourage grâce à cette différence. Le tout permet aux grêlons de croître rapidement dans les régions du nuage à fort contenu liquide et ce taux est particulièrement important autour de -13°C.
Une coupe transversale des gros grêlons montre qu'ils ont une structure en pelure d'oignons, soit des couches de croissance épaisses et translucides alternées avec des couches minces, blanches et opaques. La théorie voulait antérieurement que les grêlons étaient sujets à plusieurs allers-retours, retombant dans la zone humide puis regelant dans une nouvelle phase ascendante ce qui aurait généré les couches successives. Cependant, les recherches théoriques et sur le terrain ont démontré que ce n'est pas le cas.
En fait, le grêlon en ascension traverse des zones du nuage où la concentration d'humidité et de gouttelettes en surfusion varie. Son taux de croissance change selon les variations rencontrées. Le taux d'accrétion des gouttelettes est un autre facteur de croissance. Ces dernières s'agglomèrent par contact avec le grêlon. Ainsi lorsque le grêlon passe dans une zone riche en gouttelettes, il va acquérir une couche translucide en les capturant, alors que dans les régions de l'orage où c'est surtout de la vapeur d'eau qui est disponible, il se formera une couche de givre blanc opaque.
Finalement, le grêlon se meut verticalement à une vitesse variable qui dépend de sa position dans le courant ascendant ainsi que de son poids. C'est ce qui va faire varier l'épaisseur des couches car le taux de capture des gouttelettes surfondue (accrétion) dépend des vitesses relatives entre celles-ci et le grêlon, certaines vitesses d'ascension la favorisant. La croissance des grêlons amène le relâchement de chaleur latente ce qui peut garder l'extérieur du grêlon liquide, le rendant plus "collant". Les grêlons peuvent alors s'agglomérer à deux ou plusieurs, selon les collisions, pour en former des plus gros de forme bizarre.
Le grêlon s'éleve donc jusqu'à ce que son poids ne puisse plus être supporté par le courant ascendant ce qui prend au moins une trentaine de minutes si on en juge la force de ce courant dans un orage à grêle ayant généralement plus de 10 km de sommets. Puis il se met à redescendre vers le sol tout en continuant sa croissance par les mêmes procédés. Ce trajet unique dans l'orage est donc suffisant pour expliquer la configuration en couches de la grêle. Le seul cas où on peut parler de trajets multiples est celui des orages multi-cellulaires où un grêlon peut être éjecté du sommet de la cellule-mère et être repris dans le courant ascendant d'une cellule-fille plus intense mais il s'agit là d'un cas exceptionnel.
Il est à noter que la grosseur maximale des grêlons dans le nuage n'est pas celle que l'on retrouve au sol. En effet, une fois qu'il quitte le nuage, il commence à sublimer car l'air n'y est plus à saturation. Lorsqu'il passe dans la couche où la température dépasse le point de congélation, il se met à fondre et à s'évaporer. Ce que l'on retrouve au sol est donc ce qui n'a pu se transformer et dépend de la hauteur du niveau de congélation.
Les cumulus bourgeonnants (nuage d'averses), avec un courant ascendant beaucoup plus faible et un sommet moins froid, peuvent donner de la très petite grêle (moins de 5 mm) par un processus similaire. Cette petite grêle est parfois nommée grésil.
Dégâts
La grêle est un phénomène destructeur pour les récoltes et la propriété. Les plus gros grêlons sont aussi dangereux pour les personnes et les animaux.
Le plus gros grêlon recensé aux États-Unis mesurait 44,5 cm de circonférence (la taille d'une pastèque ou d'un melon d'eau!) et pesait 750 g.